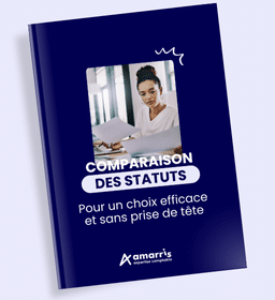Vous aviez démarré une activité en micro-entreprise en parallèle de votre activité salariée, mais votre employeur en difficulté vient de lancer une procédure de licenciement économique. Alors que vous pouvez bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), remplaçant la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP), vous vous demandez s’il est possible de cumuler CSP et régime auto-entrepreneur. L’allocation chômage mensuelle est-elle perçue dans le cadre du CSP ? Explications dans l’article.

Qu’est-ce que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?
Les points clés du dispositif
Le contrat de sécurisation professionnelle permet aux salariés d’une entreprise visés par une procédure de licenciement économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d’un ensemble de mesures favorisant leur retour à l’emploi. C’est l’employeur qui propose à son collaborateur d’en bénéficier, celui-ci a alors 21 jours pour accepter ou non la proposition de CSP.
Les principales mesures du dispositif
- Une indemnisation spécifique de reclassement pendant la durée de la convention ;
- Un accompagnement renforcé avec un entretien individualisé, un état des lieux des compétences acquises et un plan d’action personnalisé, adapté aux besoins de chacun ;
- Un suivi du plan d’action du CSP avec par exemple l’inscription à une formation complémentaire.
Lorsque le salarié accepte le CSP, le contrat de travail est immédiatement rompu et l’indemnité compensatrice de préavis est versée par votre employeur à France Travail pour financer le CSP.
Le contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé par les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (quel que soit le nombre de salariés) aux salariés totalement privés d’emploi.
Quelles sont les conditions d’éligibilité au CSP ?
- être salarié en CDI dans l’entreprise,
- remplir les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE),
- être physiquement apte à l’exercice d’un emploi.
À noter : le bénéficiaire n’est alors pas inscrit sur la site des demandeurs d’emploi, mais a un statut de stagiaire à la formation professionnelle. À la fin du CSP (la durée du dispositif d’aide s’élève à 12 mois, voire 15 mois dans certaines situations), s’il est toujours à la recherche d’un emploi, il peut s’inscrire à France Travail.
Quel est le montant de l’indemnité du CSP ?
L’allocation du CSP compense la perte de revenus soudaine et correspond à 75 % de l’ancien salaire brut pour les personnes qui sont depuis plus d’un an dans l’entreprise. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, elle sera comprise entre 57% et 75% de l’ancien salaire brut. Il n’y a pas de jour de carence, le droit à l’allocation se met en place immédiatement.
Les avantages et inconvénients du CSP
L’atout du CSP est qu’il permet au bénéficiaire une mise en action rapide et une aide plus importante dans ses démarches de retour à l’emploi. L’accompagnement personnalisé par un conseiller attitré facilite l’accès à des formations, pouvant être utiles pour une reconversion ou une création d’entreprise. Des ateliers pour organiser sa recherche de travail et préparer ses entretiens d’embauche sont souvent proposés.
La prise en charge avec le CSP offre une allocation plus élevée que l’ARE pour les salariés ayant passé au moins un an dans l’entreprise, une sécurité précieuse pendant la transition professionnelle, surtout qu’aucun délai de carence n’est exercé.
Cependant, des contraintes sont à prendre en compte. D’abord, il est impossible de créer une entreprise pendant la durée du CSP. Ensuite, l’individu ayant perdu son emploi doit communiquer régulièrement avec un conseiller dédié et accepter de participer à des sessions d’information ou de formation. Enfin, la durée du CSP est limitée à 12 mois, ou 15 mois sous certaines conditions (possible de basculer sur l’ARE à la fin du CSP).
Revenus en micro-entreprise et Allocation de sécurisation professionnelle (ASP), sont-ils compatibles ?
Le cumul entre l’ASP et les revenus de micro-entreprise dépend essentiellement du moment où la micro-entreprise a été créée. Seule une activité d’auto-entrepreneur créée avant l’entrée dans le dispositif CSP permet un cumul total avec l’ASP.
Dans cette situation, votre micro-entreprise est considérée comme une activité « conservée ». Pour cela, vous devez avoir touché un revenu pour votre activité indépendante pendant la période donnant droit au CSP.
Dès lors que vous créez votre activité pendant votre CSP, vous sortez du cadre du dispositif, mais pouvez prétendre à l’allocation de retour à l’emploi.
CSP et création d’entreprise : est-ce possible de les concilier ?
La création ou la reprise d’une activité non salariée met fin aux versements des revenus du CSP. Toutefois, si l’auto-entrepreneur respecte les conditions, il peut bénéficier de l’ARE (aide au retour à l’emploi).
S’il peut bénéficier de l’ARE, l’auto-entrepreneur peut donc cumuler la création d’une activité indépendante et le maintien de son allocation chômage, initialement versée au titre du CSP.
>> Pour aller plus loin : les dispositifs France Travail et les conditions imposées pour continuer à toucher le chômage avec le régime auto-entrepreneur.
>> Encore hésitant sur le statut à choisir lors de votre création d’entreprise, et si vous réserviez un premier rendez-vous gratuit avec un conseiller Amarris pour discuter de votre projet ?
FAQ sur le cumul CSP et auto-entrepreneur
L’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) du CSP représente 75 % du salaire brut antérieur, contre 57 % pour l’ARE. Le CSP s’étend sur 12 mois maximum tandis que l’ARE peut aller jusqu’à 24 mois selon votre situation personnelle. Le délai de versement constitue un autre point distinctif : l’ASP démarre dès la fin du contrat de travail, alors que l’ARE nécessite un délai d’attente de 7 jours.
L’accompagnement est également différent : le CSP offre un suivi renforcé avec un conseiller attitré, quand l’ARE propose un accompagnement standard.
Pour les personnes envisageant une activité indépendante, l’ARE permet plus de flexibilité dans la création d’entreprise que le CSP qui impose des conditions plus strictes.
Le fonctionnement du CSP varie selon la date de démarrage de votre activité en micro-entrepreneur. Une activité lancée avant la mise en œuvre du CSP permet un cumul total avec l’ASP, sans plafond sur vos revenus d’entrepreneur. Cela offre ainsi une stabilité financière précieuse pour développer sereinement une activité indépendante.
La procédure démarre par un rendez-vous à France Travail après la demande d’ouverture du dossier. Lors de cet entretien, un bilan personnalisé est réalisé et va guider le parcours d’accompagnement sur 12 mois.
La durée de vos droits à l’ARE se calcule après votre période de CSP. Les mois d’allocation de sécurisation professionnelle déjà perçus sont déduits du capital initial de droits. Prenons un exemple concret : avec un capital initial de 24 mois d’ARE, si vous avez bénéficié d’un CSP durant 12 mois, vos droits restants s’élèveront à 12 mois d’allocation chômage classique.
Le cumul entre un emploi salarié et le CSP reste réalisable sous certaines conditions strictes. Les contrats de travail temporaires, CDD ou missions d’intérim, ne doivent pas excéder un maximum de 6 mois cumulés sur la totalité du CSP.
Une reprise d’activité salariée en CDI ou CDD d’au moins 6 mois entraîne la fin automatique du CSP. En cas de rupture de la période d’essai, la réintégration dans le dispositif CSP devient envisageable, à condition que le terme initial du contrat ne soit pas dépassé.
Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours après la proposition du CSP pour accepter ou décliner ce dispositif. Un refus entraîne alors l’application de la procédure classique de licenciement économique. Le travailleur perçoit ainsi en même temps ses indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis.
La personne licenciée bascule vers le régime standard d’assurance chômage, avec une allocation représentant 57% du salaire brut antérieur. L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est obligatoire pour percevoir ces droits.